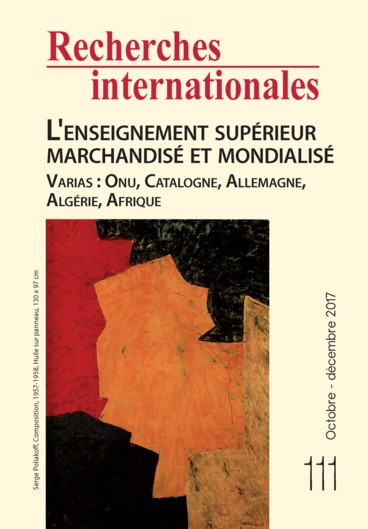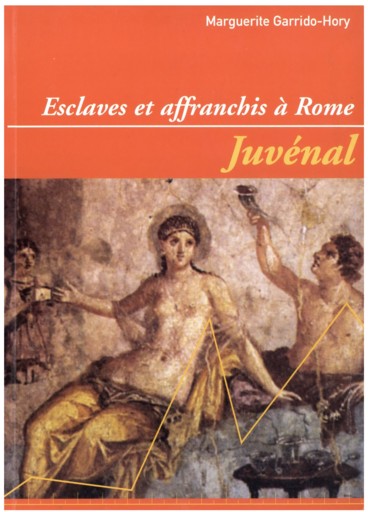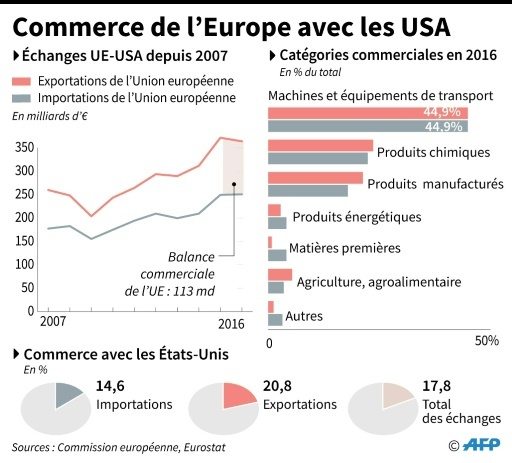La relation entre Alger et Marseille, souvent décrite comme une union indissoluble, s’approfondit davantage à mesure que les élections municipales de 2026 approchent. Le député LFI Sébastien Delogu, dont la visite en Algérie a suscité un vif intérêt médiatique, illustre cette dynamique croissante. Cette démarche, bien qu’orientée vers une visibilité politique, soulève des questions sur l’influence grandissante de l’Algérie dans le débat local, notamment à travers la communauté algérienne, qui représente une part significative de la population marseillaise.
Laurent Lhardit, député PS et président du groupe d’amitié France-Algérie à l’Assemblée nationale, a mené une délégation en Algérie quelques jours avant le 80e anniversaire des massacres de mai 1945. Ce voyage s’inscrit dans un contexte tendu entre Alger et Paris, marqué notamment par l’expulsion d’agents diplomatiques français. Cependant, les initiatives de Lhardit, axées sur une approche institutionnelle, contrastent avec celles de Delogu, qui privilégient une stratégie de proximité avec l’électorat franco-algérien.
En mai, la sénatrice Valérie Boyer (LR) a dénoncé ce qu’elle qualifie de « dérives communautaires » au sein de la police municipale de Marseille, en référence à des allégations non vérifiées. Ces accusations, soutenues par une enquête médiatique, ont conduit à une plainte de la police municipale.
Le maire de Marseille, Benoît Payan (PS), a exprimé son étonnement lors d’une visite en Algérie, déclarent : « Quand je me suis réveillé lundi matin, j’ai cru que j’étais chez moi ». Cette déclaration reflète une volonté de renforcer les liens bilatéraux, mais soulève des interrogations sur la priorité donnée aux relations internationales plutôt qu’aux problèmes locaux.